Je ne sais pas très bien comment parler de Solénoïde. Je peux simplement dire ceci : il m’a tenu sous tension — la vraie, celle qui circule dans le corps — pendant chacune de ses 800 pages. Et ce n’est pas une image : parfois, j’avais l’impression de sentir la bobine sous mes pieds, la grande spirale enfouie, prête à soulever la maison, la ville entière, et peut-être aussi moi avec.
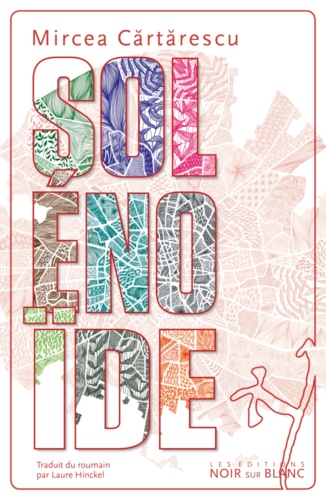
Il y a très peu de livres qui changent la manière dont on regarde les choses en sortant de chez soi. Celui-ci fait exactement ça : il vous replace dans votre propre vie comme dans un décor vaguement instable, plein de portes dérobées qu’on ne remarquerait jamais si un roumain obsédé par l’idée de réalité ne vous tapait pas doucement sur l’épaule pour vous dire : « Tu es sûr que tout ça tient debout ? »
Ce n’est pas un roman, ou en tout cas pas au sens habituel. On suit un professeur de roumain un peu raté (ou plutôt : retiré du monde) dans une Bucarest qui flotte à quelques centimètres du sol. On croise des grottes translucides, des escaliers qui n’en finissent pas, des insectes scrutés comme des divinités miniatures, des reliques corporelles conservées dans des boîtes d’allumettes — une archéologie très littérale du corps, du réel, de ce qui nous attache ici. Rien n’est là pour faire « littérature » : chaque détail semble dérivé d’un rêve mal rangé, ou d’une hallucination patiente.
Et pourtant tout est tenu, tout se répond. C’est ça qui m’a renversé. La cohérence interne. L’impression d’un monde qui n’a pas besoin du nôtre pour exister. Pas une fiction : un monde.
Il y a aussi cette façon de replacer le lecteur dans la grande question, celle qu’on évite en général parce qu’elle ne mène nulle part : qu’est-ce que la réalité, exactement ? Le narrateur affirme que nous vivons à l’intérieur de notre crâne, dans un décor en carton-pâte que nos sens fabriquent pour nous rassurer. Et si, sous la ville, sous la maison, sous la peau, quelque chose vibrait, quelque chose qu’on ne veut pas regarder ? Cette idée — très simple, presque enfantine — Cărtărescu la pousse si loin qu’elle finit par paraître raisonnable.
Il y a du Kafka, forcément. Du Borges, forcément. Des ombres de Proust et de Joyce. Et en même temps, rien de tout cela : Solénoïde parle moins de littérature que d’un monde mental qui existait déjà avant les livres, un monde où les papillons, les dents de lait, les cordons ombilicaux séchés sont des messagers. Où le fantastique n’explique rien, il constate.
Lire Solénoïde a été une expérience intense, extraordinairement libre, parfois grotesque, parfois vertigineuse ; un livre aussi vaste qu’un rêve.
Un livre-monde. Un vrai. Un qui ne ressemble à rien d’autre.
Je le range dans la petite étagère à part, avec ceux qui déplacent quelque chose. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que, la fois suivante où j’allume la lumière dans un couloir désert, je me dise que l’escalier pourrait bien continuer plus loin que prévu.


Laisser un commentaire